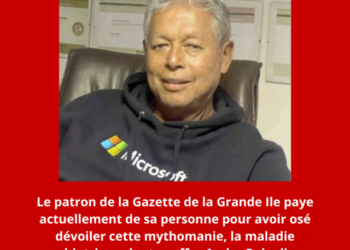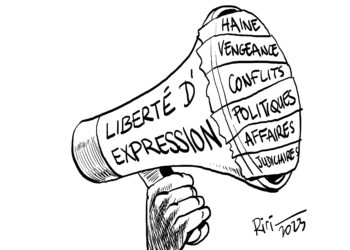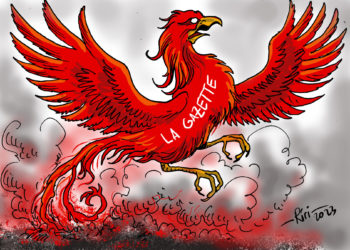Dans l’après-midi du 23 novembre 2024, le président de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) a mené des consultations sur le nouvel objectif de financement climatique. Cependant, les Pays les moins avancés (PMA) et l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS) ont exprimé leur opposition au texte proposé. Ils ont dénoncé un manque de consultation préalable et regretté l’absence de dispositions essentielles, telles que des planchers d’allocation spécifiques pour leurs groupes et un financement équivalent à des subventions pour l’adaptation ainsi que les pertes et dommages. En signe de protestation, les représentants des PMA ont quitté les discussions, ce qui a conduit à la suspension de la séance.
Dans la soirée, la plénière a repris, et les parties ont adopté une série de décisions sur des sujets moins controversés. Parmi ces avancées figurait l’adoption des décisions relatives aux articles 6.2 et 6.4 de l’Accord de Paris, qui opérationnalisent les mécanismes de coopération basés sur le marché pour la mise en œuvre de l’Accord. Cette adoption, longtemps attendue, a été saluée comme une étape clé franchie à Bakou. Toutefois, cette réussite a été éclipsée par les préoccupations autour du nouvel objectif de financement et d’autres questions prioritaires encore non résolues.
Après une longue suspension, les parties ont finalement trouvé un consensus sur l’enjeu majeur de la COP29 : le nouvel objectif mondial sur le financement climatique (NCQG). Celui-ci a été fixé à un minimum de **300 milliards USD par an d’ici 2035** pour les pays en développement, avec des contributions provenant d’une grande variété de sources – publiques, privées, bilatérales, multilatérales et alternatives. Les pays développés se sont engagés à jouer un rôle moteur, tandis que les pays en développement ont été encouragés à contribuer sur une base volontaire.
Par ailleurs, les parties ont :
– défini des orientations supplémentaires pour l’élaboration d’indicateurs permettant d’évaluer les progrès vers l’Objectif mondial d’adaptation ;
– prolongé le programme de travail renforcé de Lima sur le genre pour 10 ans ;
– donné des directives sur les futurs dialogues mondiaux et les initiatives d’investissement dans le cadre du programme de travail sur l’atténuation.
Cependant, aucun accord n’a été trouvé sur des dossiers tels que le dialogue sur la mise en œuvre des résultats du Bilan mondial ou le programme de travail pour une transition juste, dont les discussions sont reportées aux sessions des organes subsidiaires de juin 2025.
Concernant le nouvel objectif de financement, certains pays ont exprimé des critiques virulentes. L’Inde, la Bolivie et le Nigéria ont qualifié l’objectif de « dérisoire » et ont dénoncé l’absence d’une prise d’initiative véritable de la part des pays développés. Les PMA ont déploré un manque d’ambition face aux besoins criants des pays en développement, l’exclusion des pertes et dommages, et l’absence de planchers d’allocation pour les PMA et les PEID. Le Pakistan, soulignant des lacunes majeures dans l’ensemble du paquet, a appelé à un retour à la table des négociations avec un engagement renouvelé lors des prochaines sessions.
Enfin, pour des pays pauvres comme Madagascar, les enjeux restent immenses. Le pays dépend de la mise en place rapide et effective d’un système financier mondial capable de répondre à ses urgences climatiques et de développement. Cependant, le déficit colossal en financement pour l’adaptation et le développement reste un défi majeur pour Madagascar. Ce financement devrait être couvert par des flux internationaux pérennes, accessibles, à faible coût et provenant principalement de sources publiques. Or, même les fonds limités alloués à Madagascar sont confrontés à un obstacle supplémentaire : une gouvernance publique souvent perçue comme insuffisamment transparente, inefficace et marquée par la corruption, ce qui représente un risque pour les bailleurs de fonds.