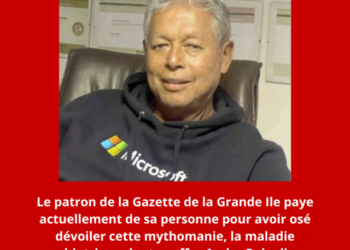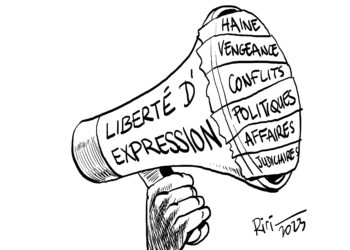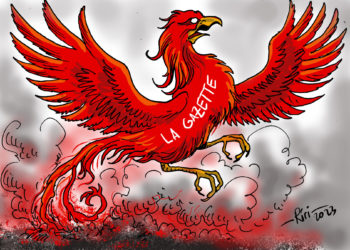Madagascar, l’un des pays les plus pauvres du monde, fait face à une conjoncture économique mondiale défavorable. Sa croissance est entravée par des inégalités grandissantes, un endettement croissant, une marge de manœuvre budgétaire limitée et une exposition accrue aux risques climatiques et géopolitiques. À cela s’ajoutent des défis liés aux avancées technologiques, aux crises sanitaires récurrentes et aux catastrophes naturelles, aggravant une situation déjà critique.
Le pays traverse une période de détresse humaine profonde. Une grande majorité de Malgaches souffrent d’une précarité grandissante, tandis que les autorités peinent à mettre en œuvre des politiques publiques efficaces, capables d’impulser un développement durable et inclusif.
Le régime actuel, perçu comme autoritaire et corrompu, semble s’appuyer sur le soutien de la communauté internationale. Mais ce soutien repose davantage sur des considérations de sécurité et de stabilité géopolitique que sur une réelle adhésion aux politiques mises en place. Stratégiquement situé dans l’océan Indien, Madagascar fait face à des défis sécuritaires majeurs tels que la piraterie maritime et la montée de l’extrémisme. Certains pays privilégient ainsi la stabilité, même au prix du maintien d’un régime critiqué pour son autoritarisme.
L’absence de leaders et de partis d’opposition forts et unis contribue également à ce statu quo. Pour certains acteurs internationaux, le manque d’alternative crédible et structurée fait craindre que tout changement entraîne une instabilité encore plus grande, justifiant ainsi une posture attentiste face aux dérives du pouvoir en place.
Parmi les freins majeurs au progrès, la question du financement reste centrale. Madagascar dépend à plus de 60 % de l’aide extérieure pour assurer son budget “d’Etat- providence “ copié au système français. Si la coopération internationale au développement a historiquement joué un rôle clé à travers des dons, des prêts et des financements concessionnels, son efficacité demeure limitée par une gouvernance gangrenée par la corruption. Tant que les ressources nationales et internationales continueront d’être détournées au profit d’une minorité, toute tentative de mobilisation du secteur privé ou de renforcement de la coopération internationale restera vaine.
Parallèlement, dans un contexte de fragilité socio-économique de Madagascar, des nouvelles puissances comme la Chine, les Émirats arabes unis , l’Inde et la Turquie renforcent leur présence à Madagascar en signant des mémorandums ou des accords de coopération avec le gouvernement en place. Si ces partenariats peuvent, en théorie, représenter des opportunités de développement, leur opacité suscite des interrogations légitimes. L’absence de débats publics et de contrôle institutionnel sur ces engagements risque d’accroître la dépendance économique du pays et de limiter sa souveraineté à long terme. Toute coopération internationale devrait s’inscrire dans une logique de gouvernance transparente et d’intérêt mutuel, garantissant que ces accords bénéficient réellement à l’ensemble de la population malgache et non à une élite restreinte.
Le véritable enjeu réside donc dans la volonté politique. Sans une refonte profonde de la gouvernance et un alignement des financements – publics et privés – sur des transformations durables, la pauvreté restera la norme pour la majorité des Malgaches. L’érosion de l’éthique politique et l’inaction face aux aspirations du peuple empêchent toute dynamique de réforme ambitieuse. Or, sans engagement réel en faveur du développement durable et d’une gestion transparente des ressources, Madagascar continuera de s’enfoncer dans la pauvreté et l’instabilité.
Le soutien tacite de la communauté internationale à un régime autoritaire et corrompu pose une question fondamentale : la stabilité doit-elle primer sur la justice et le développement ? Fermer les yeux sur l’impunité et la mauvaise gouvernance ne fera que perpétuer la pauvreté et renforcer un système au service d’une minorité.
Il est temps d’exiger des comptes. L’aide internationale ne doit plus être un chèque en blanc, mais un levier de transformation. Seuls la transparence, l’État de droit et une mobilisation collective – citoyens, société civile et acteurs internationaux – permettront de briser ce cycle de stagnation. Madagascar n’a pas besoin de simples promesses, mais d’un engagement ferme pour une gouvernance intègre et tournée vers l’intérêt général.
Le statu quo n’est plus une option. L’avenir de millions de Malgaches en dépend.