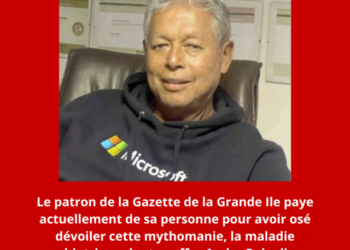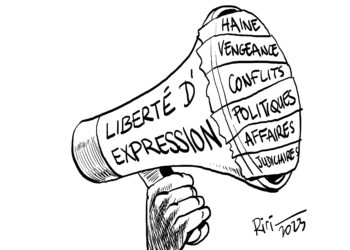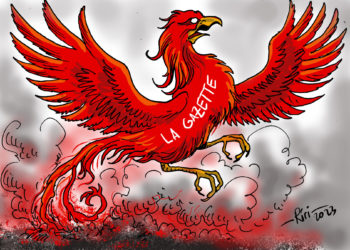Madagascar, perle de l’océan Indien, se trouve aujourd’hui à un carrefour décisif. Entre les promesses d’un avenir démocratique et les dérives d’un pouvoir de plus en plus centralisé, le pays semble osciller entre l’illusion d’un État de droit et les réalités d’un régime autoritaire naissant. L’histoire du monde regorge d’exemples de nations ayant emprunté des trajectoires similaires, certaines sombrant progressivement dans l’autocratie, d’autres parvenant à s’extirper du cycle de l’instabilité pour embrasser la prospérité démocratique et économique. L’heure est venue d’examiner, avec lucidité et rigueur, où se situe Madagascar dans cette équation.
Démocratie ou dictature ? Un diagnostic contrasté
La question est simple, mais la réponse est complexe. Existe-t-il un outil fiable pour déterminer si un État est une démocratie ou une dictature ? Oui. Des indices tels que le Democracy Index de The Economist, le Freedom in the World de Freedom House, ou encore les évaluations du Varieties of Democracy Project (V-Dem) permettent d’analyser des paramètres clés : liberté d’expression, qualité des élections, indépendance de la justice, répression de l’opposition.
Quand on applique ces grilles à Madagascar, le constat est nuancé. Si les élections sont régulièrement organisées, elles sont souvent contestées, et les résultats donnent lieu à des tensions. La presse, bien que dynamique, fait face à des pressions croissantes. L’opposition politique se plaint d’intimidations, et la justice est souvent perçue comme inféodée au pouvoir en place. À mesure que ces tendances se renforcent, Madagascar semble s’éloigner du modèle démocratique pour glisser vers un régime hybride, à mi-chemin entre autoritarisme et pluralisme de façade.
Les récents scrutins illustrent cette dérive. En novembre 2023, Andry Rajoelina a été réélu président de la République de Madagascar dès le premier tour des élections présidentielles du 16 novembre 2023. Cependant, cette victoire a été entachée de contestations [1], l’opposition dénonçant des irrégularités et des fraudes massives. La Haute Cour constitutionnelle a validé la réélection d’Andry Rajoelina, malgré les contestations de l’opposition [2].
Parallèlement, la société civile malgache exprime son mécontentement face à la dégradation des services publics. À Antananarivo, la capitale, les habitants endurent des pénuries d’eau potable et des coupures d’électricité fréquentes, exacerbant le quotidien difficile des résidents majoritairement en situation de pauvreté [3].
Ces événements récents soulignent les défis auxquels Madagascar est confronté et rappellent des situations similaires vécues par d’autres nations.
L’ombre des régimes qui ont basculé
Si l’on cherche des exemples de pays ayant suivi une évolution similaire à celle de Madagascar, plusieurs noms viennent en tête.
La Turquie, sous Recep Tayyip Erdoàn, a connu un effondrement progressif de ses institutions démocratiques. Ce qui était autrefois une démocratie en plein essor est devenu une autocratie électorale, où les voix dissidentes sont muselées et où le pouvoir judiciaire a perdu son indépendance.
En Hongrie, Viktor Orbán a transformé un État membre de l’Union européenne en un régime où la presse et l’opposition sont systématiquement affaiblies.
Le Venezuela, autrefois l’un des pays les plus riches d’Amérique latine, est aujourd’hui plongé dans une crise économique et humanitaire due à des décennies de mauvaise gestion, de corruption et d’accaparement du pouvoir.
Dans chacun de ces cas, le processus s’est fait graduellement. Il a commencé par des attaques contre la presse, des restrictions subtiles aux libertés politiques, puis s’est accéléré avec des réformes légales taillées sur mesure pour concentrer le pouvoir entre les mains d’un seul homme.
Madagascar est-il sur cette pente ? Certains signaux l’indiquent. Mais d’autres nations ont montré qu’un autre destin était possible.
Les nations qui ont réussi leur transition démocratique
À l’opposé, certains pays ont su éviter la dérive autoritaire et construire une démocratie stable, couplée à un développement économique durable.
Prenons le Ghana. Dans les années 1980, ce pays ouest-africain était marqué par l’instabilité et des coups d’État à répétition. Mais grâce à une transition démocratique maîtrisée, un renforcement des institutions et une économie diversifiée, le Ghana est aujourd’hui un modèle de stabilité politique en Afrique [4].
L’Indonésie, après la chute de Suharto en 1998, aurait pu sombrer dans le chaos. Mais grâce à des réformes démocratiques profondes et une stratégie économique axée sur l’industrialisation et le commerce international, elle est devenue une puissance émergente [5].
Même le Chili, après des années de dictature sous Pinochet, a su restaurer une démocratie fonctionnelle et construire une économie solide basée sur l’innovation et la diversification.
Autre exemple avec la Corée du Sud (Années 1960 – Aujourd’hui) :
- Situation initiale : Après la guerre de Corée, le pays était dirigé par des régimes autoritaires successifs, avec une économie largement agricole et dépendante de l’aide étrangère.
- Transition : Dans les années 1980, des mouvements pro-démocratie ont conduit à la tenue d’élections libres en 1987, accompagnées de réformes économiques ambitieuses.
- Aujourd’hui : La Corée du Sud est une démocratie avancée et une puissance économique mondiale, notamment grâce à son industrie technologique et manufacturière.
Ces pays montrent qu’aucun destin n’est figé. À condition d’entreprendre les bonnes réformes, Madagascar pourrait suivre leur exemple.
Le choix d’un développement dans une démocratie
Si l’on observe les trajectoires des pays qui ont réussi leur transition démocratique et économique, des constantes apparaissent.
- Stabiliser le climat politique : sans stabilité, aucune réforme ne peut aboutir. Cela passe par la fin des conflits internes et une gouvernance inclusive.
- Renforcer les institutions : une démocratie ne peut fonctionner sans une justice indépendante, des élections crédibles et une presse libre.
- Lutter contre la corruption : une économie ne peut croître si la rente et le clientélisme dominent. Des agences indépendantes de lutte contre la corruption doivent être mises en place.
- Réformes Économiques pour Diversifier les Sources de Revenus Aucun pays ne s’est développé en restant dépendant d’un seul secteur. Il faut moderniser l’agriculture, industrialiser le pays et investir dans le numérique et les services.
Une fois la stabilité politique assurée et la gouvernance renforcée, ces pays ont mis en place des réformes économiques visant à diversifier leur économie et à stimuler la croissance. Voici les principales stratégies qu’ils ont adoptées :
4.1. Modernisation de l’Agriculture pour la Rentabiliser
Objectif : Transformer l’agriculture de subsistance en un secteur productif et exportateur.
Actions menées :
- Investissement dans les infrastructures rurales (routes, irrigation) pour faciliter l’acheminement des produits agricoles.
- Mécanisation et amélioration des techniques agricoles (ex. semences améliorées, accès aux engrais).
- Accès facilité au financement pour les petits agriculteurs (microcrédits, coopératives).
- Création de filières d’exportation agricoles (café et cacao au Ghana, fruits et légumes au Chili).
- Encadrement des petits producteurs pour assurer la qualité et la compétitivité des produits (ex. Corée du Sud avec la réforme des coopératives agricoles).
Exemple : Le Ghana a diversifié son agriculture en modernisant la production de cacao et en développant d’autres cultures comme les noix de cajou et les ananas, réduisant ainsi sa dépendance à une seule ressource.
4.2. Industrialisation et Transformation Locale des Ressources
Objectif : Éviter la dépendance aux exportations brutes et créer de la valeur ajoutée.
Actions menées :
- Création de zones industrielles et d’incitations fiscales pour attirer les investisseurs (ex. Indonésie avec ses parcs industriels).
- Développement d’industries locales pour transformer les matières premières (ex. raffineries de cacao au Ghana, industrie du bois au Chili).
- Encouragement des partenariats public-privé pour financer de grandes infrastructures industrielles.
- Développement d’une politique d’exportation pour favoriser la vente de produits transformés plutôt que bruts.
Exemple : L’Indonésie a réduit ses exportations de bois brut et a investi dans l’industrie du meuble, ce qui a permis de créer plus d’emplois et d’augmenter les revenus du pays.
4.3. Développement du Secteur des Services et du Tourisme
Objectif : Exploiter les richesses naturelles et culturelles pour attirer des devises étrangères.
Actions menées :
- Développement d’infrastructures touristiques (hôtels, aéroports, routes).
- Promotion internationale des destinations touristiques (campagnes marketing).
- Encadrement du secteur pour éviter la dégradation de l’environnement.
- Formation du personnel hôtelier et touristique pour garantir un service de qualité.
Exemple : Le Chili a fortement développé l’écotourisme dans la Patagonie et le désert d’Atacama, attirant des millions de visiteurs chaque année.
4.4. Investissement dans l’Éducation et la Formation Professionnelle
Objectif : Développer une main-d’oeuvre qualifiée pour répondre aux besoins de l’industrie et des services.
Actions menées :
- Réforme du système éducatif pour inclure des formations techniques et professionnelles adaptées au marché du travail.
- Partenariats avec des entreprises pour créer des programmes de formation en alternance.
- Développement des universités et des écoles spécialisées dans les secteurs stratégiques (ex. ingénierie, informatique, gestion).
Exemple : La Corée du Sud a mis en place des écoles techniques et des formations en ingénierie, ce qui a permis de développer son industrie technologique (Samsung, Hyundai).
4.5. Amélioration du Climat des Affaires et Stimulation de l’Entrepreneuriat
Objectif : Encourager la création et la croissance d’entreprises locales.
Actions menées :
- Réduction des démarches administratives pour créer une entreprise (ex. simplification des licences commerciales).
- Accès facilité au financement pour les PME (banques publiques, microfinance, fonds d’investissement).
- Protection juridique des investisseurs pour favoriser la confiance et attirer les capitaux étrangers.
- Lutte contre la corruption et la bureaucratie pour éviter les freins aux investissements.
Exemple : Le Ghana a mis en place un guichet unique pour les entreprises, réduisant drastiquement le temps nécessaire pour créer une société et facilitant l’accès au financement.
4.6. Modernisation des Infrastructures et des Transports
Objectif : Faciliter le commerce intérieur et extérieur.
Actions menées :
- Construction de routes, ports et aéroports pour améliorer la logistique et les exportations.
- Développement des réseaux d’électricité et d’eau potable pour garantir un cadre attractif aux industries et aux investisseurs.
- Investissement dans les télécommunications et le numérique pour moderniser l’économie (fibre optique, 4G/5G).
Exemple : L’Indonésie a modernisé ses routes et ses ports pour dynamiser son commerce extérieur et connecter ses nombreuses îles, facilitant ainsi les échanges économiques.
4.7. Renforcement du Commerce International et Diversification des Partenaires
Objectif : Ne pas dépendre d’un seul marché et sécuriser les exportations.
Actions menées :
- Signature d’accords de libre-échange avec plusieurs blocs économiques (ex. Chili avec l’UE et la Chine).
- Diversification des marchés d’exportation pour ne pas être vulnérable aux fluctuations d’un seul client (ex. Corée du Sud qui s’est tournée vers les États-Unis et l’Asie).
- Encouragement des entreprises locales à l’exportation via des incitations fiscales et des accompagnements.
Exemple : Le Chili a signé des accords de libre-échange avec plus de 60 pays, ce qui lui permet d’exporter facilement ses produits agricoles et industriels.
Pour suivre un chemin similaire, Madagascar pourrait :
- Moderniser son agriculture pour en faire un moteur de croissance.
- Développer son industrie pour transformer ses ressources localement.
- Exploiter son potentiel touristique en investissant dans les infrastructures et la promotion.
- Faciliter l’entrepreneuriat et attirer les investissements étrangers avec une meilleure gouvernance et des infrastructures modernes.
- Investir dans l’éducation et la formation : le capital humain est la richesse principale d’une nation. Sans une population instruite, il est impossible de bâtir une économie compétitive.
- Améliorer le climat des affaires : attirer les investisseurs demande un environnement économique stable, avec des infrastructures modernes et des lois claires.
- S’ouvrir au commerce.
La situation économique de Madagascar est étroitement liée à la corruption endémique qui mine le pays. En 2023, Madagascar se classait 145e sur 180 pays dans l’Indice de Perception de la Corruption de Transparency International, avec un score alarmant de 25/100 [6]. Cette corruption généralisée entrave le développement économique en décourageant les investissements, en augmentant les coûts des transactions et en affaiblissant les institutions publiques.
À Madagascar, la corruption gangrène l’économie et plombe les perspectives de développement. Face à ce fléau, les autorités affichent leur volonté de réagir : la nouvelle Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption pour 2025 vise à renforcer le cadre légal, à rendre opérationnels les pôles anti-corruption régionaux et à instaurer une agence dédiée au recouvrement des avoirs illicites [7].
En parallèle, la sensibilisation devient un enjeu clé. Des initiatives comme le Guide de lutte contre la corruption pour les jeunes cherchent à inculquer une culture d’intégrité aux nouvelles générations [8]. Mais si les intentions sont louables, leur application reste le vrai défi. Car en Afrique, les lois pullulent, mais leur mise en oeuvre demeure aléatoire. Trop souvent, les élites politiques et économiques se soustraient aux règles qu’elles imposent à la population, nourrissant un climat d’impunité.
Pour enrayer cette spirale, il est impératif de juger les biens mal acquis, de surveiller l’évolution des patrimoines des dirigeants avant et après leurs mandats et de supprimer toute immunité pour les responsables corrompus. Plus encore, seule une justice indépendante, un contrôle transparent des finances publiques et une société civile engagée permettront de rompre ce cycle infernal. Car sans véritable volonté politique alignant les déclarations et les actions, la corruption continuera d’étouffer Madagascar et d’hypothéquer son avenir.