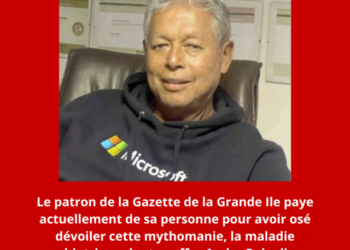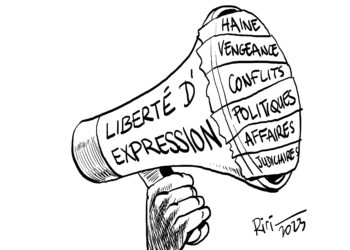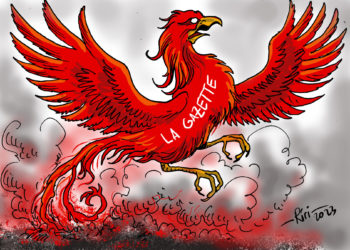Dans un contexte géopolitique en pleine mutation, marqué par l’émergence d’un monde plus pragmatique et transactionnel, les autorités malagasy sont appelées à repenser leur politique étrangère pour mieux défendre les intérêts de la majorité de la population.
L’exemple de la politique commerciale de l’administration Trump illustre bien ce tournant. En imposant des droits de douane parmi les plus élevés du monde industrialisé, les États-Unis ont repositionné leur marché comme un levier d’influence. Entreprises et États se bousculent désormais à Washington pour négocier des accords bilatéraux, obtenir des exemptions ou des conditions préférentielles. Face à ces sollicitations, l’administration américaine s’est montrée ouverte à des contre-propositions, créant ainsi un rapport de force favorable à ses propres intérêts économiques.
Ce phénomène s’inscrit dans une dynamique plus large : celle d’un « monde à la carte », où les grandes et moyennes puissances établissent des partenariats sur la base de calculs d’intérêts immédiats, plutôt que de visions communes à long terme. Madagascar n’échappe pas à cette logique. Les récents accords conclus avec la Turquie, les Émirats arabes unis et d’autres partenaires en témoignent.
Mais dans un pays fragilisé par une gouvernance encore largement marquée par la corruption, ce modèle de coopération transactionnelle n’est pas sans risque. Il ouvre la voie à des négociations opaques, souvent détournées au profit de minorités proches du pouvoir, au détriment de l’intérêt général. Si rien n’est fait pour instaurer davantage de transparence, ces pratiques pourraient accentuer les inégalités sociales et économiques déjà criantes.
Il est temps que les décideurs publics malagasy fassent preuve d’une véritable volonté politique en matière de transparence et de gestion éthique des affaires publiques. L’avenir du pays — et surtout celui de sa majorité silencieuse -en dépend.
L’avenir nous dira si le patriotisme de nos dirigeants actuels sera à la hauteur de ce tournant décisif.