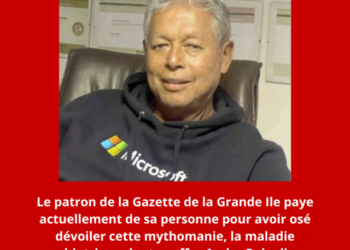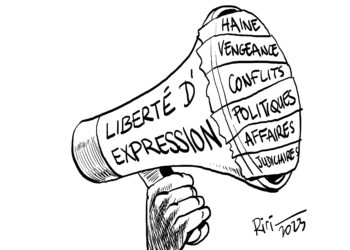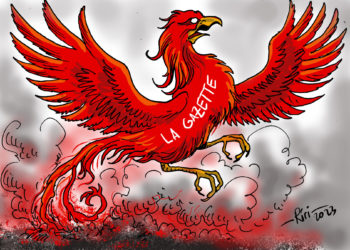De retour d’un (trop bref) voyage au pays… Retrouvé cette vibration harmonique que je ne ressens que là-bas… Retrouvé cette tendresse infinie pour le pays et pour les gens .… Vu le « Nampoina » de Raymond Ranjeva… Et éveillé des questionnements…
Il y a des pays et des histoires qui, on en a l’impression, se dessinent comme des lignes droites : une antiquité, une féodalité, une monarchie, une révolution, une république, et puis la suite… Il est des nations qui racontent leur histoire avec assurance… Il est des histoires qu’on lit comme des fables, ou comme des contes avec des héros et des héroïnes, histoires répétées mille fois… Et puis il y a Madagascar… Oui, nous avons eu des rois et des reines… Oui, nous avons eu des héros… Et peu de méchants narrés dans notre histoire… Mais quelle en est réellement leur trace ?
Madagasikara ne se laisse pas enfermer dans une ligne historique. C’est une peinture, comme une spirale… Une île palimpseste[1] dont chaque époque recouvre l’autre sans jamais l’effacer. Chaque règne, chaque régime, chaque république est un coup de pinceau sur une fresque ancienne qu’on devine encore en dessous… Mais dont on a du mal à percevoir globalement le sens.
C’est un pays dont la mémoire travaille en sous-main et où tout demeure. Les ancêtres, qu’on exhume pour mieux les honorer… Les blessures et les humiliations, qu’on tait, mais qu’on transmet en silence… Les hiérarchies anciennes, qu’on croit abolies, mais qui ressurgissent dans les alliances, dans les collusions, dans les rapports à l’autre… Et dans les rapports aux madinika en particulier… Et dans les silences lourds lors des réunions de famille.
Le vrai chantier de Madagascar n’est pas que matériel : il est certainement plus symbolique, plus social et plus intime que matériel. Il ne s’agit pas que de construire des routes ou d’attirer les investisseurs. Il s’agit de construire un “nous”, non pas de manière incantatoire ou, pire, un “nous” de discours d’investiture, mais un “nous” enraciné construit sur la reconnaissance des différences et des douleurs.
Ce “nous” est aujourd’hui largement vacillant, fragilisé par des tensions anciennes ravivées à chaque crise, à chaque élection… tensions structurelles qui, tant qu’on ne les regardera pas en face, cantonneront le rêve national à un mirage dans la vibration de chaleur du désert de l’Ihorombe.
Il faut dire les choses. Madagascar est une société (bien trop) profondément hiérarchisée. Et ces hiérarchies n’ont pas disparu avec la République. Elles ont changé de costume, de langage, de posture, mais elles sont là. Dans la manière dont on nomme ou dont on ne nomme pas. Elles sont là dans qui a le droit d’épouser qui. Dans qui détient la terre, qui détient le pouvoir, qui détient la parole.
Les vieilles fractures sont encore vives… Ces fractures qu’on ne doit surtout pas évoquer sous peine de passer pour un… révisionniste ? De celles qu’on ne veut pas dire entre les hauts plateaux et les côtes, avec des ressentiments qui remontent aux guerres de conquête entre les royaumes ou qui remontent même avant… mais que la colonisation puis les républiques successives ont maladroitement renforcées… Entre les descendants d’anciens esclaves et les familles nobles ou roturières… Et dans des territoires, villages où l’on se connaît trop bien pour que le passé soit tout à fait passé… Entre les régions valorisées et les régions reléguées… Entre les voix qui portent et celles qu’on oublie toujours d’écouter.
On veut faire nation sans faire mémoire. Et certains osent parler d’unité sans oser parler d’injustice.
Une nation ne se bâtit pas dans l’oubli. Elle se bâtit dans la reconnaissance de son identité, de son histoire, de ses difficultés, de ses dissensions, de ses conflits…
On ne peut pas comprendre Madagascar sans écouter ses silences. Ceux des femmes et des hommes qui portent une économie informelle qu’on ne sait sortir de la pauvreté… Ceux des jeunes qui créent malgré tout… Ceux des artistes qui chantent une révolte… Ceux des paysans qui endurent les aléas climatiques, mais refusent de partir.
On ne peut pas comprendre la Grande Ile si on n’écoute pas ce qu’elle n’a jamais cessé de murmurer : qu’il faut du temps pour accorder des voix dissonantes… Qu’on ne guérit pas les blessures avec des institutions manara penitra plaquées ou des symboles copiés… Qu’on ne décrète pas une nation sur la base d’une constitution plagiée ou de discours lénifiants sur la puissance de notre culture et de nos traditions.
Il faut sentir notre Grande Ile… La faire vivre… L’accepter dans sa complexité… Avec ses déséquilibres et sa résilience que l’on lit parfois en résignation… Il faut ici peut-être commencer par dire les choses. Nommer les fractures et regarder notre histoire en face.
Parler de l’esclavage. De celui que nous avons pratiqué et subi. Parler du mépris social hérité. Parler de la hiérarchie de peau, de ces hiérarchies de noms, de ces hiérarchies d’origine qui sont celles qui nous font certainement le plus mal dans les non-dits, mais tellement vécus.
Mettre fin à ces non-dits qui empêchent le vivre-ensemble… Ouvrir des espaces de parole, de mémoire, de création… Refonder l’éducation pour qu’elle soit aussi une école de la reconnaissance. Valoriser toutes les langues, toutes les cultures, tous les visages du pays.
Et dans cette démarche, ne pas avoir peur d’inventer. Le génie malgache a su créer du neuf avec du vieux. De la grandeur avec du peu. Tout est là, disponible en termes de matière première pour un projet de société enraciné.
Madagascar peut s’avérer être une grande nation. Pas nécessairement au sens des puissances militaires ni au sens des classements économiques et des indicateurs courants des grands argentiers. Mais au sens profond d’une communauté qui choisit de se reconnaître, de se respecter, de se rêver ensemble.
Ce pays n’est pas un désert peuplé de nomades errants. C’est un champ de possibles qu’il faut oser labourer. Où il faut oser dire que tout n’est pas bon dans la tradition, que tout n’est pas fiable dans la modernité, que tout n’est pas figé dans les identités.
Il faut une parole politique qui ne divise pas, mais qui répare… Une parole qui parle plus au cœur qu’à la raison, parce que sans cœur aucune idée de nation ne peut tenir debout… Il faut une parole lucide, mais bienveillante… Une parole ferme qui puisse rassurer, réveiller, entrainer, proposer un devenir et une vision… Une parole qui puisse enseigner que Madagasikara est un puzzle qui demande qu’on accepte chaque pièce, même celles qu’on a longtemps cachées sous le tapis.
Et peut-être qu’alors, au détour d’une fête, d’une réunion, d’un congrès, d’une messe, d’une manifestation, d’un concert, sur une place, au hasard d’un slam, d’un débat dans une université, d’une visite dans une prison, d’un tournoi de football, le “nous” malgache apparaîtra. Un “nous” qui ne gommera pas les différences, mais qui les accordera. Un “nous” à plusieurs voix. En une polyphonie comme nous savons les élaborer…
Patrick Rakotomalala (Lalatiana PitchBoule)… 15 Avril 2025