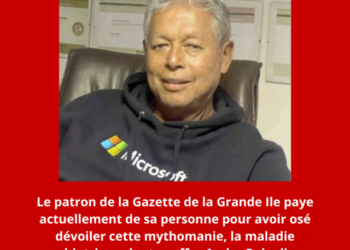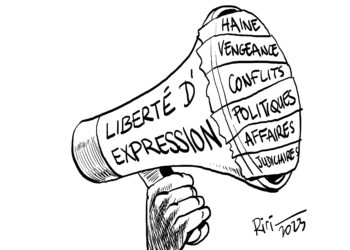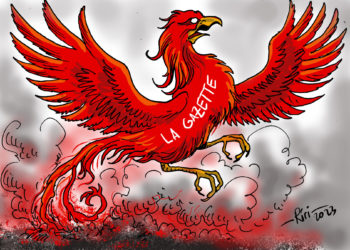Des chiffres qui dérangent… mais qui reflètent une réalité douloureuse
Les données internationales ne tombent pas du ciel. Les indicateurs de développement humain (IDH), le seuil de pauvreté, le taux d’accès à l’éducation, aux soins de santé ou encore l’insécurité alimentaire sont mesurés avec rigueur, et contextualisés pour chaque pays. Les agences comme la Banque Mondiale ou le PNUD utilisent des méthodologies standardisées, mais elles prennent bien en compte les réalités locales.
Dire que ces barèmes « ne sont pas faits pour Madagascar » revient à balayer du revers de la main la souffrance quotidienne de millions de Malgaches. Ce ne sont pas les indicateurs qui sont en cause, mais les politiques publiques qui ont failli.
Un peuple muselé et frustré
Contrairement à l’image optimiste que tente de projeter Rajoelina, la majorité de la population malgache n’est pas heureuse. Elle est frustrée, épuisée par la pauvreté, démoralisée par le manque de perspectives. Pire encore, elle est empêchée de s’exprimer librement dans un climat de répression. Ce silence apparent ne traduit pas une satisfaction, mais bien une peur de parler.
Un chef d’État déconnecté de son peuple
Plutôt que de reconnaître les défaillances de son régime, Rajoelina préfère accuser les instruments de mesure. Il refuse de voir que sous sa gouvernance, Madagascar a glissé vers les bas-fonds des classements mondiaux en matière d’éducation, de santé, d’infrastructures, de droits humains et de revenus.
Ce déni de réalité est non seulement dangereux, mais aussi profondément insultant pour les Malgaches qui luttent chaque jour pour survivre.